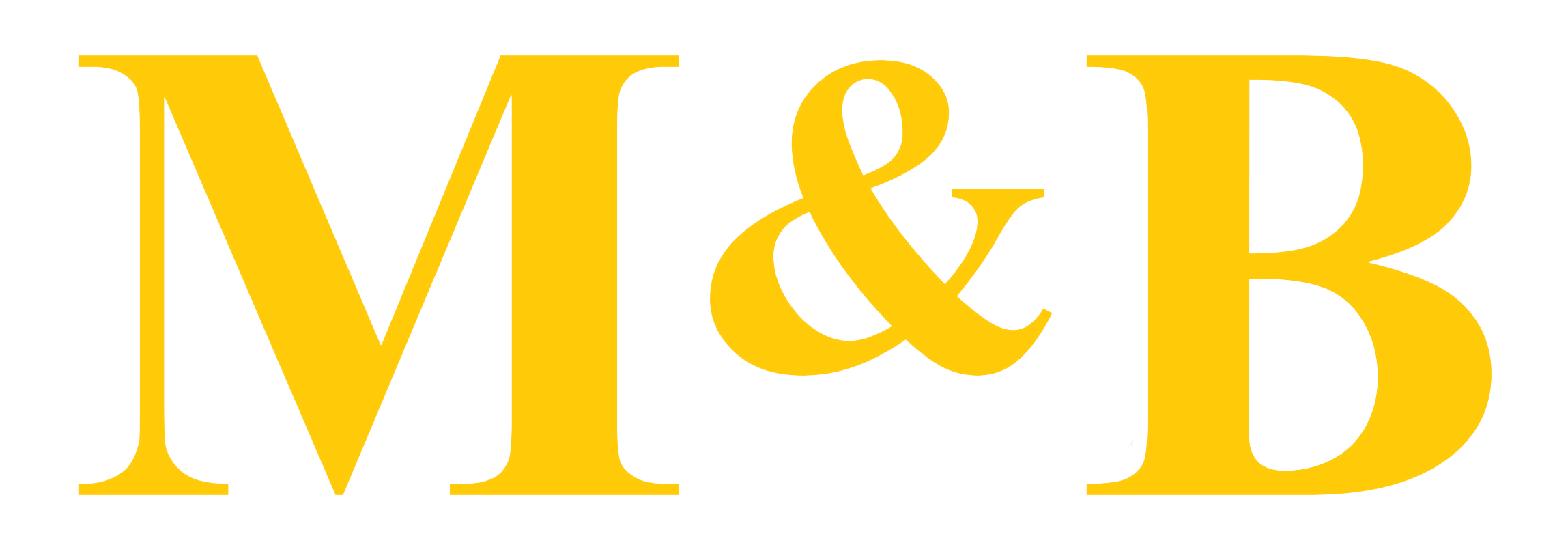Lors de la 32ème réunion du Conseil des ministres tenu le vendredi 21 février dernier, la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires étrangères en charge de la Coopération internationale et Francophonie a présenté la note d’information sur l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Conseil des pays producteurs d’huile de palme (en Anglais : Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC en sigle). Ce Conseil a été créé le 21 novembre 2015 par les deux plus grands producteurs, à savoir l’Indonésie et la Malaisie, et comprenait avant l’adhésion de la RDC quatre pays membres : l’Indonésie, la Malaisie, le Honduras et la Papouasie Nouvelle Guinée. La Colombie, le Ghana et le Nigeria en sont membres observateurs. La production d’huile de palme illustre à elle seule et mieux que tout autre produit, la déchéance du Congo de l’après-indépendance.
Le CPOPC poursuit plusieurs objectifs majeurs, notamment : représenter les intérêts des pays producteurs d’huile de palme sur la scène mondiale ; promouvoir le développement durable de l’industrie de l’huile de palme ; et répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux qui affectent le secteur. Huile végétale extraite de la pulpe des fruits du palmier à huile, un arbre originaire d’Afrique tropicale, dont est également extraite l’huile palmiste tirée du noyau de ses fruits, l’huile de palme occupe un rôle important dans le monde moderne.
En effet, elle est présente partout, depuis la margarine jusque dans les cosmétiques, en passant par le rouge à lèvres, le chocolat, les détergents, les carburants et l’alimentation animale. L’huile de palme est un composant que l’on retrouve dans un nombre important de produits du quotidien. Elle est l’huile végétale la plus produite, consommée et vendue au monde, représentant 40% de la consommation globale d’huiles végétales en 2020. Mais ce produit représente l’exemple le plus criant de l’effondrement de l’appareil économique laissé par le colonisateur lors de l’accession du Congo à l’indépendance.
Premier producteur et exportateur du monde en 1960
Originaire d’Afrique, le palmier à huile est introduit par les Anglais et les Hollandais en Malaisie et Indonésie à la fin du 19ème siècle comme arbre de décor. Les plantations commerciales vont commencer à partir de 1911 en Malaisie et en 1918 en Indonésie, à la même époque où les Britanniques débutent la même activité en Afrique occidentale, particulièrement au Nigeria. Le Congo belge ne suivra le mouvement qu’à partir du début des années 1930, avec l’installation de la société britannique Lever, productrice de savons et des cosmétiques, qui fusionne avec la hollandaise Margarine Union – Margarine Unie pour former Unilver.
Le Congo rattrape vite son retard et s’impose vite parmi les plus grands producteurs mondiaux d’huile de palme. L’activité d’Unilever, avec ses usines, ses équipements sociaux, médicaux et scolaires et ses réseaux de transport, a structuré certains territoires et amorcé parfois, comme dans le cas du district du Kwilu, une véritable construction régionale comme l’indique le professeur Henri Nicolaï de l’Université libre de Bruxelles dans une étude sur le sujet.
En 1960, lors de l’accession du Congo à l’indépendance, avec une production de 197.000 tonnes et des exportations de 167.000 tonnes, le pays est à la fois le premier producteur et premier exportateur mondial d’huile de palme, suivi par l’Indonésie, du Nigeria et de la Malaisie. On va alors assister à deux politiques diamétralement opposées. Dans les pays asiatiques, Indonésie et Malaisie, des politiques visionnaires vont être mises en œuvre afin de booster la production ainsi que la transformation industrielle de l’huile de palme. Le gouvernement indonésien a commencé à déployer des efforts soutenus pour promouvoir les plantations d’arbres à la fin des années 1970. Il a mis en place un programme dans le cadre duquel les sociétés de plantations d’État aidaient les agriculteurs à cultiver du palmier à huile. Les sociétés de plantation fournissaient des plants, une assistance technique et un financement aux petits exploitants. Leurs récoltes étaient achetées par les usines des sociétés. Aujourd’hui, l’Indonésie est devenue, de loin, la première productrice d’huile de palme du monde, totalisant à elle seule près de 60% de la production mondiale.
Disparu de radars des grands producteurs
A l’inverse de pays producteurs d’Asie, la production huilière va connaître une véritable aux enfers en RDC. Les troubles politiques de l’immédiat après-indépendance vont perturber la production et le fonctionnement des sociétés productrices au Kwilu, au Kasaï et à l’Equateur, les principaux foyers de production. Par la suite, les sociétés huilières vont connaître d’autres difficultés qui vont réduire leurs perspectives d’avenir. Il s’agit, d’abord, l’application de la loi Bakajika de 1966 qui reconnaît à l’État la propriété exclusive et inaliénable du sol. Désormais, l’Etat ne cèdera plus les terres en propriété aux sociétés industrielles mais se contentera de concéder leur exploitation par des baux emphytéotiques d’une durée de 25 ans. Or cette durée est inférieure au cycle d’exploitation d’une palmeraie ce qui pourrait décourager de nouveaux investissements.
Classement des dix plus grands producteurs d’huile de palme dans le monde
| Rang | Pays | Pourcentage de la production mondiale (pourcentage) | Production (1000 MT) |
| 1er | Indonésie | 58 | 46 500 |
| 2ème | Malaisie | 24 | 19 200 |
| 3ème | Thaïlande | 5 | 3 700 |
| 4ème | Colombie | 2 | 1 900 |
| 5ème | Nigeria | 2 | 1 500 |
| 6ème | Guatemala | 1 | 990 |
| 7ème | Papouasie Nouvelle Guinée | 1 | 830 |
| 8ème | Brésil | 1 | 600 |
| 9ème | Côte d’Ivoire | 1 | 600 |
| 10ème | Honduras | 1 | 595 |
Source : US Department of Agriculture
Mais le coup fatal sera la « zaïrianisation » générale des entreprises étrangères décidée par Mobutu en 1973, une véritable politique de destruction du tissu économique du pays. L’État zaïrois confisque les petites et moyennes entreprises appartenant à des étrangers et les offre gracieusement à des zaïrois, bien souvent des politiciens qui n’avaient jamais géré ne fut-ce qu’une boutique auparavant. Ensuite, c’est le tour des grosses sociétés qui sont confiées à des personnes issues de la clientèle politique du président Mobutu. La quasi-totalité des sociétés « zaïrianisées » sont cadavériques après quelques années. Le maréchal Mobutu décide alors de faire marche arrière et « rétrocède » les entreprises à leurs anciens propriétaires. Cependant, ces derniers les retrouvent parfois dans un tel état comateux qu’ils nécessitent beaucoup de moyens pour les relancer. Beaucoup refuseront carrément de les reprendre.
Résultats des courses : la RDC a disparu de radars des principaux producteurs d’huile de palme du monde. Même en Afrique, elle arrive loin derrière le Nigeria, la Côte d’ivoire, et le Cameroun. Aujourd’hui, le pays importe même une partie de sa consommation. Des pays d’Amérique qui ont introduit le palmier à huile assez récemment par des plants venus notamment du Congo comme le Honduras (1943), la Comombie (années 50) et le Brésil (années 60) dépassent largement la RDC en termes de production.
Source : https://finance-cd.com/