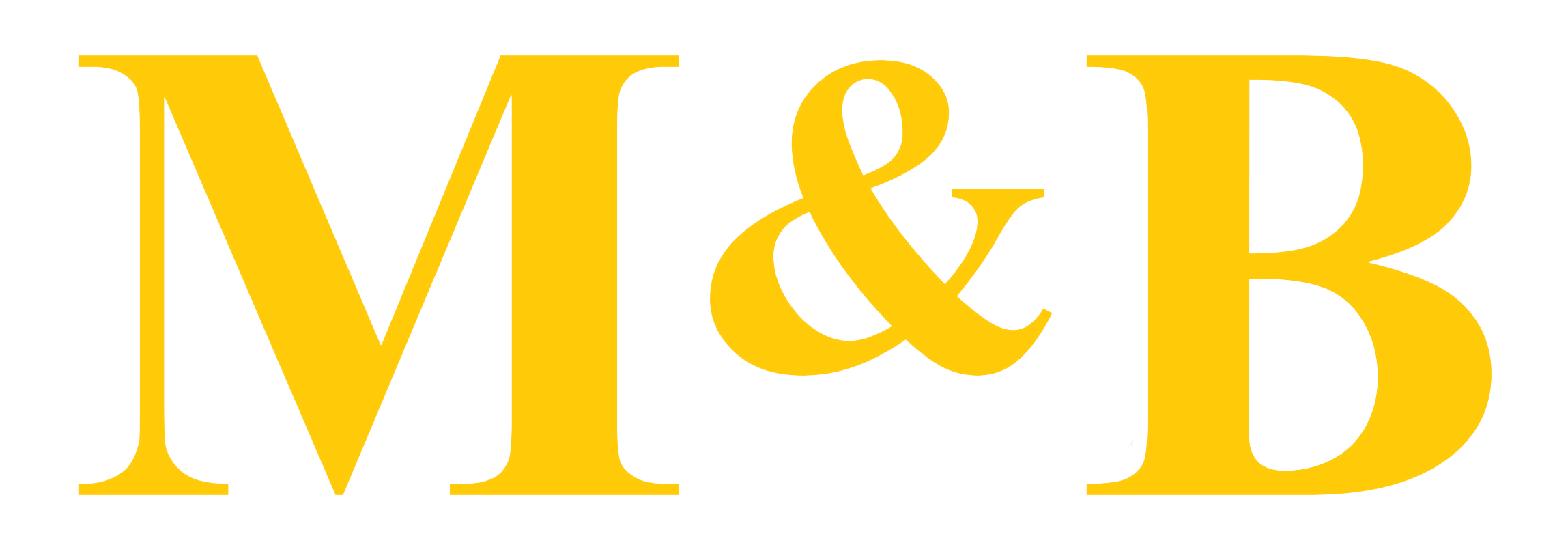Monsieur l’Ambassadeur, quels sont les projets phares de la coopération française en RDC, notamment dans le domaine minier et au niveau de la gouvernance ?
En ce qui concerne notre coopération le secteur minier, de nouvelles priorités ont été fixées conjointement avec les autorités congolaises pour notre coopération dans les quatre années à venir. Parmi les axes clés, certains concernent directement l’exploitation minière, tels que la production d’énergie électrique et les infrastructures de transport pour désenclaver les régions.
En ce qui concerne les mines, notre objectif est de permettre aux Congolais de bénéficier pleinement de cette activité cruciale pour l’économie congolaise.
Pour cela, nous avons mis en place un programme de formation en ingénierie. Deuxièmement, nous poursuivons la coopération entre le BRGM, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, et le Service géologique national du Congo pour la création d’une Banque Nationale de données géoscientifiques. Ce projet a été officiellement lancé lors de la Mining Week et représente un investissement d’un million d’euros.
À ma connaissance, un accord avait déjà été conclu avec le BRGM en avril 2024, mais nous n’avons pas observé de suite concrète.
Vous avez raison, cet accord avait été signé. À présent, le lancement des activités est en cours. Des retards ont été causés par la situation actuelle, que vous connaissez bien. Mais le mois dernier, le BRGM nous a rendu visite, et tout est désormais en place pour démarrer véritablement les activités.
Pensez-vous que l’AFD a bien ajusté sa stratégie face à l’évolution du contexte économique congolais ? Pour être cash, on peine à percevoir l’impact réel de l’Agence Française de Développement.
Pour ce qui est de l’impact réel, nous parlons d’un pays de 100 millions d’habitants. Avec une capacité annuelle d’intervention de l’AFD d’environ 150 millions d’euros, il serait illusoire de prétendre que notre seule action puisse transformer la RDC. C’est le premier point. Deuxièmement, nous sortons d’un cycle de 4 ans raccourci. Un accord signé en 2021 prévoyait un engagement de 500 millions d’euros sur la période 2021-2024, répartis sur 8 priorités.
L’objectif a-t-il été atteint ?
Cet objectif a été atteint en seulement 3 ans, avec 560 millions d’euros engagés sur les 3 dernières années. J’ai initié de nouvelles négociations avec les autorités congolaises pour redéfinir et restreindre nos priorités, car en couvrir 8 revient à n’en avoir aucune.
Depuis plusieurs mois, nous discutons avec le gouvernement sous la direction de la Première ministre pour réduire ces priorités à 4, basées sur nos intérêts communs et les priorités traduites dans le budget. Nous sommes sur le point de conclure ces négociations pour les quatre prochaines années, en mettant l’accent sur le secteur de l’énergie, suivi des transports et du désenclavement, puis de la forêt et de l’agriculture durable. Enfin, la coopération universitaire sera notre quatrième priorité, poursuivant nos efforts en matière de formation en ingénierie.
L’idée est donc de donner aux Congolais la possibilité de tirer parti du potentiel du Congo et de le mettre en pratique. Actuellement, nous organisons diverses formations dans le secteur minier. La deuxième phase que nous allons initier concernera le projet INGA3, avec des formations pour ingénieurs en BTP, ingénieurs hydrauliques, électriques, ainsi que pour tout le personnel nécessaire à la réalisation du projet et à la gestion du barrage ultérieurement.
Comment la France envisage-t-elle d’intervenir ? Vous avez mentionné Inga, y a-t-il d’autres initiatives ?
Un autre exemple concerne la situation de pénurie intermittente à Lubumbashi. À Kisangani, il s’agit d’une pénurie structurelle. Pour remédier à cela, la France, avec l’UE, va lancer un projet de 90 millions d’euros pour rénover la centrale existante et entendre le réseau de distribution en coordination avec un investisseur la remettre à un gestionnaire privé. Cela fonctionne donc sur un modèle de partenariat public-privé. Afin de rendre l’énergie accessible à toute la population, nous prenons en charge une partie des coûts de réhabilitation pour abaisser le coût de revient, ce qui permet à l’opérateur de proposer des tarifs abordables. C’est donc du concret, avec le barrage de la Tshopo, par exemple.
En ce qui concerne Inga, cela deviendra notre priorité pour les années à venir, car ce sujet est crucial pour nous pour deux raisons : il est important pour le secteur minier, puisque, comme vous le savez, il y a un déficit de plus de 2 000 MW dans le sud, ce qui freine la production. Mais surtout, avec Inga, nous serons en mesure de fournir un kilowattheure à 3 centimes aux centres urbains, en commençant par Kinshasa. Et un kilowattheure à 3 centimes rend le charbon de bois trop coûteux.
En remplaçant l’utilisation du charbon de bois par une électricité renouvelable et bon marché, nous protégeons concrètement la forêt congolaise. Cet engagement envers l’électricité renouvelable répond donc à deux intérêts communs entre nous et le Congo : la croissance de la production minière et la promotion de sa transformation au Congo, ainsi que la préservation des forêts du bassin du Congo, qui constitue le deuxième poumon de la planète.
Donc, la France arrête le saupoudrage de l’aide ?
La multiplication des priorités e problème du saupoudrage vient du fait qu’il n’était pas réellement désirée. Nous avions des programmes définis par les partenaires congolais, ce qui est la norme. Toutefois, chaque ministère présentait son secteur comme une priorité, affirmant que le développement national était impossible sans intégrer l’éducation primaire, la santé maternelle et infantile, les pistes rurales, etc. Cela créait une compétition où seuls les projets bénéficiant du soutien politique du président ou du Premier ministre étaient validés. J’ai donc souhaité mettre fin à cette approche, pour discuter d’abord des intérêts communs avec les Congolais. Reconnaître ces intérêts est crucial, car l’engagement de l’AFD dans ce pays n’est pas de la charité ; il vise nos intérêts communs. Il est donc essentiel de s’accorder sur la meilleure manière de promouvoir ces intérêts communs, aboutissant à quatre secteurs prioritaires pour les deux partenaires.
Vus de l’extérieur, les Européens semblent un peu désorganisés sur les projets d’envergure.
C’est un point important, car la pratique des projets en « équipe Europe » se développe de plus en plus. Nous avons plusieurs projets initiés par l’AFD qui sont cofinancés par l’Union européenne.
Concernant le désenclavement, nous œuvrons sur le corridor nord, avec la construction d’une route entre Lisala, Zoango, et jusqu’à la RCA pour accéder au port de Douala, avec un cofinancement de l’UE. Nous avons aussi des projets d’assainissement à Kinshasa. Vous avez sans doute constaté qu’à chaque grande pluie, des inondations surviennent. Cela résulte d’un entretien inadéquat ou de systèmes de drainage inadaptés. Nous avons donc un vaste projet de 17 millions d’euros que l’UE vient compléter.
Concernant les ressources stratégiques, aucun grand groupe français n’est présent ni ne manifeste d’intérêt pour la RDC. Pourquoi ? Comment expliquez-vous ce paradoxe entre le discours politique et l’absence d’entreprises françaisesfrançaise dans le secteur minier congolais ? De plus, le stand de la France était presque vide à la DRC Mining Week.
Tout à fait. La principale cause est connue. C’est l’environnement des affaires en RDC. Les autorités en sont conscientes. Elles ont fait de l’amélioration du climat des affaires, l’environnement des affaires une priorité. Quand je suis venu dans le Lualaba et le Haut-Katanga, j’ai rencontré les entreprises, et notamment les responsables de la FEC. Les chiffres recueillis par la FEC sont implacables. En 2024, la moyenne des contrôles fiscaux pour les entreprises du Lualaba, c’était 134 contrôles par an. Ensuite, toutes sortes de harcèlements, de redressements qui s’additionnent, d’un système de contrôle fiscal où on a des vérificateurs, des survérificateurs qui n’examinent pas la qualité de l’audit précédente, mais repartent à zéro. Donc, il y a un environnement extrêmement difficile.
C’est donc la principale raison ?
Oui, des entreprises françaises minières pourraient potentiellement être actives, mais elles préfèrent investir ailleurs. Eramet, depuis quelques années, avait anticipé sur la transition énergétique. La société voulait développer ses activités au-delà du nickel et du manganèse, et donc avait fait du lithium une priorité. Son dernier investissement majeur, c’est le lithium en Argentine. Il est de moins bonne qualité qu’en RDC, mais c’est plus facile. L’environnement des affaires y est plus normé, plus connu. On peut faire le même constat avec Orano, vu qu’il y a aussi de l’uranium ici. Le dernier investissement d’Orano, c’est en Mongolie. Ce n’est pas ici. Et ça, je pense que la principale raison, c’est vraiment l’environnement des affaires parce que les autres goulots d’étranglement, logistique et énergie, sont compensés par la qualité exceptionnelle du minerai congolais par rapport aux autres pays production.
Comment pouvez-vous, en tant que diplomate, contribuer à l’amélioration de cet environnement entrepreneurial ?
Il existe deux approches. La première consiste en un dialogue direct avec les autorités. Il s’agit d’une initiative qui concerne l’ensemble des partenaires étrangers. À cet égard, nous avions un groupe de travail, dirigé par les Pays-Bas, consacré à l’amélioration du climat des affaires. Ce groupe incluait aussi des représentants chinois, turcs et égyptiens. Nous avons donc collaboré et formulé des recommandations concises : une phase d’urgence, suivie par un travail approfondi. Tout cela a été remis au ministre des Affaires étrangères et au vice-premier ministre chargé du Plan. Voilà pour la première partie.
La seconde partie concerne les discussions menées avec le FMI et la Banque mondiale pour que les programmes récemment conclus – et nous venons d’avoir la première évaluation du FMI – intègrent dans leurs mesures des actions concrètes pour l’amélioration du climat des affaires, afin d’accompagnere motiver les autorités congolaises. Il y a donc une cohérence dans l’approche de tous les partenaires, car, comme je l’ai mentionné, certains partenaires non traditionnels qui ne font habituellement pas partie des partenaires techniques et financiers classiques ont été inclus dans cette démarche. Ce ne sont pas seulement des initiatives bilatérales, mais aussi multilatérales, puisque tout le monde comprend que c’est un enjeu crucial pour développer le potentiel du Congo.
Parlant justement du potentiel, des perspectives et de l’avenir, dans quels domaines clés la France peut-elle encore se distinguer en RDC ?
Je reviens à ce que je vous ai dit. Les secteurs où nous apportons une vraie valeur ajoutée sont aussi ceux que nous avons classés comme prioritaires, notamment l’énergie. En Afrique, nous avons de grands barrages récemment construits par EDF au Cameroun, comme Nachtigal Nartigal, réalisés par des entreprises privées. Donc, en matière d’énergie, nous maîtrisons bien, non seulement en production, mais également en transport. Il y a une véritable valeur ajoutée concernant les sous-stations, par exemple. C’est pareil pour la logistique. En termes de logistique et de transport, des entreprises françaises mènent déjà, dans d’autres pays africains, des partenariats public-privé dans le domaine routier et ferroviaire. Ces domaines sont devenus des priorités avec la RDC, car nous partageons des intérêts communs. Je vous ai donné l’exemple du barrage de la Tshopo, où un financement public est fourni pour réduire le coût initial, qui est ensuite complété par un investissement privé pour l’extension du réseau de distribution. C’est avec cette approche que nous tentons de développer ces nouveaux secteurs prioritaires.