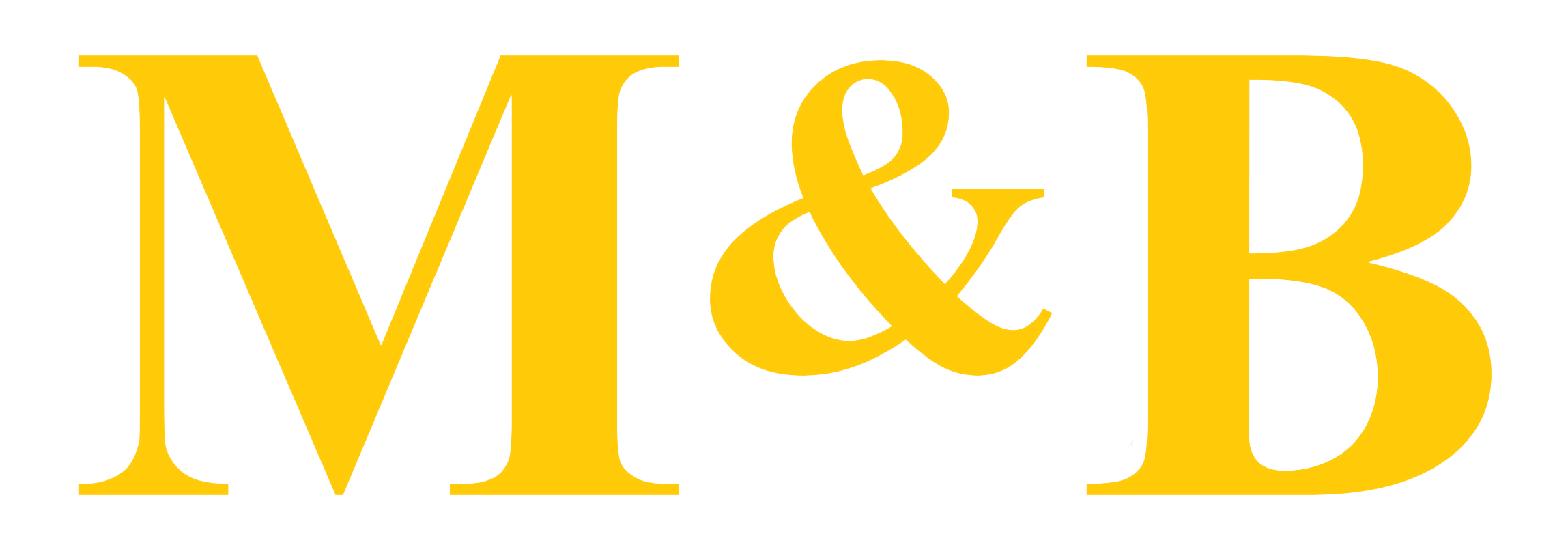Bonjour Olivier, pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Je suis né en Belgique en 1982, d’une mère flamande et d’un père congolais qui exerçait la profession de pédiatre. En 1984, ma famille a quitté la Belgique pour s’installer à Kinshasa, où j’ai vécu jusqu’aux événements tragiques des pillages de septembre 1991 – période durant laquelle notre école fut saccagée.
Environ un an après, en août 1992, mon père décéda. À la suite de ces événements, ma mère prit la décision de retourner s’établir en Belgique, où j’ai complété l’ensemble de mon parcours scolaire et académique, avec un séjour d’études en France. J’ai obtenu un master en droit en Belgique, suivi d’un second master à Grenoble spécialisé dans l’étude des conflits armés.
Il faut reconnaître que mon parcours académique ne correspond pas au schéma traditionnel pour un professionnel du secteur minier.
Pourtant, bien que ma formation ait été centrée sur le droit international public, elle trouvait déjà sa source d’inspiration dans le contexte congolais.
Mon mémoire de master en droit porta spécifiquement sur le rôle de la Cour pénale internationale dans la reconstruction de la RDC. Quant à mon master grenoblois, il s’articula autour d’une thèse analysant les missions de maintien de la paix dans la région des Grands Lacs.
Après vos études, vous êtes donc devenu avocat ?
J’ai effectivement débuté ma carrière en tant qu’avocat au barreau de Bruxelles. Après deux années de pratique en Belgique, j’ai saisi l’opportunité de rejoindre un cabinet d’avocats au Burundi. Cette décision répondait à une volonté délibérée de pratiquer le droit dans une zone de post-conflit et de m’immerger dans l’écosystème des organismes internationaux. Ce fut à cette période cruciale que j’ai pris pleinement conscience du pouvoir transformateur des investissements privés et du monde des affaires sur la reconstruction d’une nation.
Par la suite, mon parcours m’a conduit successivement en Tanzanie, puis en Afrique du Sud, où j’ai intégré le cabinet de premier plan Webber Wentzel, alors en pleine élaboration de sa stratégie panafricaine. Ce fut également dans ce cadre professionnel que j’ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse – une rencontre aussi imprévue que décisive, the rest is history.
Comment avez-vous commencé chez Ivanhoe Mines ?
À la suite de mon passage chez Webber Wentzel, j’ai cofondé mon propre cabinet de conseil avec un ancien de Webber Wentzel. Ivanhoe devint notre tout premier client en 2013, lorsque la directrice financière de l’époque – Marna Cloete, aujourd’hui présidente du groupe – me contacta après m’avoir observé lors d’une conférence. Elle me localisa sur les réseaux sociaux dans l’intention de me recruter pour un rôle juridique interne. Cependant, je préférai alors conserver mon indépendance en travaillant avec Ivanhoe Mines comme consultant externe via mon cabinet.
Notre collaboration se développa de manière intermittente au fil des années, me permettant d’observer attentivement l’évolution de la société.
La découverte du gisement de Kakula en 2016 marqua un tournant décisif : les communiqués de presse devinrent progressivement plus impressionnants, révélant la nature véritablement transformative que ce projet pourrait représenter pour la RDC. Le véritable changement survint en 2020 lorsque Marna fut promue à la présidence du groupe.
Quelques semaines plus tard, lors d’un appel téléphonique désormais mémorable, elle déclara : « Cela fait maintenant 7 ans que j’essaie de te recruter. Voici ce que j’ai en tête pour toi. » En raccrochant, je me suis tourné vers mon épouse pour lui annoncer : « C’est maintenant ou jamais. » Cette opportunité représentait en effet le poste de rêve pour celui que j’étais – un professionnel désireux de contribuer concrètement au développement de son pays d’origine.
Quel était l’intitulé de ce job de rêve ?
C’était Vice-président Affaires Publiques, l’interface entre le gouvernement et la société.
Quelles ont été vos premières missions quand vous avez commencé avec Ivanhoe Mines ?
Nous développons actuellement trois projets distincts en République Démocratique du Congo. Notre portefeuille comprend un projet d’exploration avancée, Western Foreland, ainsi que deux opérations majeures : Kamoa Copper et Kipushi. Lorsque j’ai rejoint l’entreprise, Kamoa Copper se situait à quelques mois seulement du démarrage de sa production. Cette période critique exigeait un travail intense de sensibilisation pour faire connaître l’ampleur du projet et démontrer son importance stratégique pour le développement économique du pays. Parallèlement, nous devions orchestrer la préparation opérationnelle complète pour l’entrée en production : obtenir l’ensemble des autorisations réglementaires, sécuriser les certifications nécessaires à l’exportation, et établir les protocoles logistiques pour la commercialisation de nos produits.
Mon arrivée a coïncidé avec une période charnière : l’Honorable Sama Lukonde venait justement d’entrer en fonction en tant que Directeur Général de la Gécamines. Dès que les restrictions sanitaires liées à la pandémie nous ont permis de reprendre les déplacements, nous nous sommes immédiatement rendus à la rencontre du nouveau DG pour entamer des discussions constructives.
Cette rencontre marqua le début concret de la relance du projet Kipushi.
Le processus de négociation qui s’en est suivi a demandé un travail considérable – dans lequel je me suis personnellement investi – pour aboutir, quelques années plus tard, à l’accord définitif permettant la mise en production.
Je me trouvais justement sur le site de Kipushi hier encore, et je dois reconnaître que voir cette mine en production représente pour moi une grande fierté professionnelle. La complexité des négociations et l’engagement requis pour parvenir aux derniers accords de joint-venture restent gravés dans ma mémoire comme l’un des chapitres les plus exigeants de ma carrière.
Quand avez-vous été nommé PCA de Kamoa ?
Je siège au conseil d’administration de Kamoa depuis mars 2021. Lors de mon arrivée, Louis Watum occupait la présidence du conseil avant d’être repositionné sur le projet Kipushi peu après. La succession fut assurée par Ben Munanga, dont la nomination comme président du conseil marquait une transition naturelle pour l’entreprise.
Cette année, suite à la décision de M. Munanga de prendre sa retraite, le groupe a choisi de me confier la fonction de président du conseil d’administration. J’hérite ainsi du legs de deux prédécesseurs remarquables, dont les parcours exceptionnels ont profondément marqué le secteur minier congolais. Cette nomination représente pour moi un honneur particulier, mais aussi la reconnaissance d’une vision que je partage avec le groupe pour l’avenir de ce projet minier d’envergure mondiale.
Quel est le bilan des 30 dernières années pour Ivanhoe Mines au Congo ?
En effet, nous approchons d’une étape significative : 30 années d’engagement. La présence d’Ivanhoe Mines en RDC remonte à 1997, une période marquée par des défis substantiels, notamment des complexités sécuritaires persistantes.
Notre parcours a été caractérisé par une longue phase d’exploration qui a porté ses premiers fruits avec la découverte de Kamoa en 2008. La clairvoyance de Robert Friedland et de son équipe s’est alors manifestée par une décision contre-intuitive : poursuivre les efforts d’exploration malgré cette réussite initiale.
Cette persévérance fut récompensée en 2016 par la découverte de Kakula, un gisement aux caractéristiques exceptionnelles qui se classe parmi les plus riches au monde. Le développement a ensuite progressé à un rythme remarquable – seulement 5 années séparent la découverte de la première production de concentré de cuivre en mai 2021, une réalisation d’autant plus notable qu’elle s’est déroulée pendant la période disruptive de la pandémie Covid-19. Ce récit souligne un investissement massif engagé dans un contexte de profonde incertitude géologique. La conviction générale dans le secteur établissait que la ceinture de cuivre centre-africaine s’interrompait aux environs de Kolwezi. Notre approche diffère fondamentalement des acquisitions traditionnelles : il s’agit ici d’une découverte générée en interne, dans des zones sans antécédents d’exploitation minière intensive. Cette situation présente à la fois un avantage et un défi distinctif. L’absence d’héritage minier signifie que nous n’héritons pas de relations conflictuelles historiques entre les communautés et les opérateurs miniers. En revanche, cela nous impose la responsabilité de concevoir ex nihilo un modèle de relations communautaires robuste et durable – un exercice de « social engineering » qui représente l’un des aspects les plus exigeants de notre mission.
Pouvez-vous faire un point, de ce qui a été fait avant votre arrivée ?
L’exploration constitue le véritable ADN de notre groupe. Pendant de nombreuses années, le secteur minier doutait qu’Ivanhoe Mines parviendrait véritablement à développer une mine opérationnelle. Kamoa représentait ainsi notre première expérience concrète de passage à la phase de production.
Naturellement, nous avons recruté des professionnels expérimentés, mais il demeure exact que cela constituait une nouvelle donne stratégique pour Ivanhoe Mines en tant qu’organisation intégrée. À mon arrivée, le projet se trouvait dans la phase critique de développement des infrastructures souterraines, tandis que les installations de surface n’en étaient qu’à leurs tout premiers stades.
Pourtant, contre toute attente, nous sommes parvenus à atteindre la phase de production dès mai 2021, soit seulement quelques mois plus tard. Nous avons ensuite adopté une stratégie de développement par phases successives, permettant de financer une part substantielle des investissements grâce au cash-flow généré par la production elle-même. Cette approche financièrement disciplinée a transformé notre modèle de croissance de l’exploration à la production.
Puis la deuxième phase ?
Oui, la deuxième phase, qui consistait en la construction d’un deuxième concentrateur, a été achevée en avril 2022 et a doublé la capacité de production du projet. Et puis l’année passée, en 2024, un troisième concentrateur a été mis en service, faisant de Kamoa Copper le troisième plus grand complexe minier au monde, en termes de capacité de production.
Vous avez, je crois, une grande fonderie ?
Absolument. Il s’agit effectivement de la plus grande fonderie de ce type au monde, représentant une évolution stratégique cruciale qui nous permettra de transformer notre concentré de cuivre en anodes de cuivre raffiné.
Le démarrage opérationnel est prévu pour la fin de cette année, la construction ayant été achevée au cours du premier semestre.
Cet investissement dépasse le milliard de dollars américains, portant l’enveloppe totale investie dans Kamoa Copper à plus de six milliards de dollars.
Ce chiffre témoigne de l’engagement à long terme de notre groupe en RDC. La fonderie ne constitue pas seulement une infrastructure industrielle : elle incarne une ambition plus large de positionner Kamoa comme ambassadeur du secteur minier congolais et s’aligne parfaitement avec la politique d’industrialisation du pays. Notre focus immédiat se concentre sur la mise en service réussie de cette fonderie. Cependant, notre vision dépasse le seul complexe de Kamoa-Kakula. Nous poursuivons activement nos investissements dans l’exploration au Western Foreland, situé à l’ouest de notre complexe actuel, où nos équipes travaillent à identifier les prochaines découvertes minières qui pourraient prolonger notre impact économique en RDC pour les décennies à venir. Ce sont des dizaines de millions de dollars investis dans l’exploration chaque année.
On a déjà fait trois découvertes, qu’on appelle Kiala, Makoko et Kitoko. Et on a un espoir que d’ici quelques années, on devrait pouvoir construire de nouvelles mines et donc continuer l’investissement et le développement du secteur minier dans le Lualaba.
Comme PCA de Kamoa, qu’aimeriezvous laisser comme empreinte sur le projet ?
La vision et l’empreinte vont bien au-delà de mon rôle de Président du Conseil d’Administration. En intégrant mon rôle au sein du groupe et de Kamoa, mon ambition est de faire de Kamoa un catalyseur de croissance durable et inclusive, qui profite autant à nos employés qu’aux sous-traitants congolais et aux communautés voisines. Je défends une vision résolument tournée vers l’extérieur : avec un secteur minier de cette envergure, la RDC doit, selon moi, viser la compétitivité régionale et internationale. Notre potentiel est tel qu’il devrait permettre l’émergence de sociétés de sous-traitance de classe mondiale et former des experts capables de s’exporter jusqu’en Australie ou en Amérique latine. Nos ambitions ne doivent pas être confinées par nos frontières nationales.
Certaines initiatives favorisant les capitaux nationaux ont leur mérite, cependant j’estime qu’il faut aller plus loin. Notre débat doit évoluer d’un récit centré sur la nationalité vers un impératif de compétitivité.
Nous devons nous concentrer sur un transfert de compétences robuste, afin que nos entreprises puissent rivaliser sur la scène internationale sans s’appuyer uniquement sur des mesures protectionnistes.
Tel est le pari à long terme pour Kamoa : identifier les déficits de compétences avec les secteurs public et privé et investir stratégiquement pour qu’ici une décennie, la RDC atteigne une compétitivité internationale. Si Kamoa y contribue, ce sera alors pari gagné.