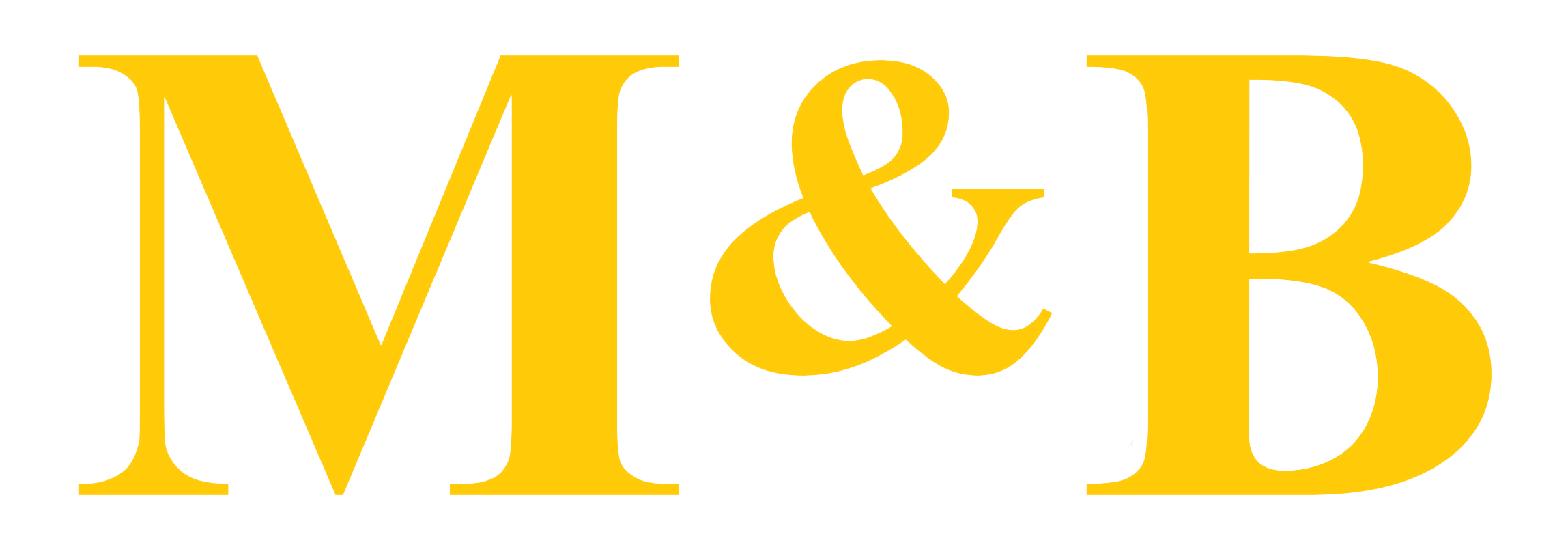Des millions de vies sans trace
En 2025, plus d’un milliard de personnes dans le monde ne possèdent aucune preuve légale d’identité, selon l’UNICEF. L’Afrique concentre plus de la moitié de ces “invisibles” : 550 millions d’individus, dont 237 millions sans acte de naissance. Un quart des enfants africains de moins de cinq ans ne sont pas déclarés, et les deux tiers des décès ne sont jamais enregistrés.
Sans identité juridique, impossible d’accéder pleinement à la santé, à l’éducation, au vote, à la propriété ou à la justice. Être sans papier dans son propre pays, c’est vivre en marge du contrat social, sans reconnaissance de la communauté nationale.
« Un certificat de naissance, c’est la preuve de qui vous êtes, de votre existence. Sans lui, pas d’école, pas de soins, pas de protection », résume une responsable régionale de l’UNICEF.
« Sans carte, je ne peux même pas retirer l’argent de mon frère »
À la sortie d’un bureau de Western Union, Madame Kabeya : « Mon frère travaille en Belgique et m’envoie un peu d’argent quand il le peut. Pour le retirer, on me demande une pièce d’identité. Ma seule carte, c’est ma carte d’électeur – mais l’encre s’est effacée, la photo aussi. Aujourd’hui, comme l’agent ne me connaît pas, je n’ai pas pu retirer mon argent.» Elle marque une pause avant d’ajouter, lasse :
« Le président avait promis de nouvelles cartes d’identité pour remplacer celles de la CENI. Mais nous sommes déjà dans son deuxième mandat, et toujours rien. Tout le monde promet, le ministre, l’ONIP… mais sur le terrain, rien ne bouge. Il faut que les politiques tiennent enfin parole. »
Une question de droits… et de développement
L’absence d’état civil fiable mine le développement des États. Sans statistiques sur les naissances, les décès ou les migrations, il est impossible de planifier les politiques publiques. À l’inverse, un système d’enregistrement solide devient un levier de gouvernance et de croissance : il permet de cibler les besoins, d’élaborer des budgets réalistes, de lutter contre la fraude et de renforcer la participation démocratique.
Dans un contexte de crises et de déplacements massifs, la fragilité des registres d’état civil a aussi des conséquences sécuritaires. Les conflits au Kivu ont déplacé plus de 500 000 personnes début 2025. Sans identités formelles, difficile de distinguer citoyens, réfugiés ou combattants, compliquant la gestion humanitaire et la prévention des infiltrations.
Quand la donnée devient territoire
La « souveraineté des données » repose sur un principe simple : les données doivent être soumises aux lois du pays où elles sont générées. Mais dans les faits, beaucoup d’États africains confient encore l’hébergement de leurs registres à des serveurs étrangers. Un risque majeur, selon plusieurs experts : en cas de cyberattaque, d’ingérence ou de conflit, ces bases pourraient être exploitées par des puissances hostiles.
Garantir la résidence nationale des données devient donc une condition de souveraineté. Cinq principes s’imposent : la création, la localisation, l’hébergement, la gestion et la protection des données doivent rester sous le contrôle exclusif de l’État.
Au pays, avancées et lenteurs pour le permis de conduire biométrique
La RDC offre un exemple concret des tensions entre ambition et exécution. Depuis novembre 2024, le pays a lancé la délivrance de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Mais la réforme traîne : un moratoire sur les contrôles est prévu jusqu’au 30 juin 2025 pour laisser aux conducteurs le temps de s’aligner. La délivrance a surtout démarré dans quelques grandes provinces — Kinshasa, Kongo-Central, et plus récemment Lubumbashi mais les files d’attente sont longues, les coûts élevés, et l’adoption reste lente. Bienvenu, chauffeur confirme : ” J’ai fait les pieds pendant 3 jours de suite pour pouvoir enfin m’enroler!”
L’identité numérique, nouveau visage du citoyen
Carte biométrique, passeport électronique, identifiant unique… L’identité numérique est la version dématérialisée de l’identité physique. Elle permet d’accéder à des services publics ou privés en ligne : santé, éducation, fiscalité, participation civique.
On distingue deux types d’identités numériques :
- Les identités régaliennes, créées et garanties par l’État (registre national, carte d’identité, passeport) ;
- Les identités non régaliennes, utilisées pour le commerce, les réseaux sociaux ou les plateformes de services.
L’enjeu, pour les pays africains, est d’éviter la dépendance technologique. Sans infrastructure nationale, l’identité numérique risque de devenir un service importé, administré par des entreprises étrangères.
Un accélérateur pour la modernisation des États
Bien conçus, les systèmes d’identité numérique offrent aux États une source d’information stratégique : recensement, statistiques démographiques, suivi sanitaire, fiscalité, sécurité.
Ils permettent de renforcer le droit des citoyens à être reconnus à la naissance comme à la mort, et de mieux cibler les politiques publiques : santé, éducation, justice, impôts.
À terme, ces outils favorisent une administration plus efficace et plus transparente, tout en modernisant la relation entre l’État et ses administrés.
Une promesse pour les citoyens
Pour les populations, les bénéfices sont multiples :
- Meilleure qualité de vie grâce à un accès facilité aux services publics ;
- Réduction du risque d’usurpation d’identité ;
- Simplification des démarches administratives et mobilité accrue ;
- Sentiment renouvelé d’appartenance nationale.
« L’identité numérique, c’est aussi une question de dignité », souligne un acteur du secteur. « C’est le moyen de rendre à chacun la visibilité qu’il mérite. »
Le tournant africain
Certains pays montrent la voie. En Afrique de l’Ouest, le taux d’enregistrement des naissances est passé de 45 % en 2015 à 59 % en 2023, malgré la croissance démographique.
L’objectif fixé par les Nations unies — un enregistrement universel des naissances d’ici 2030 — reste ambitieux, mais plus d’une vingtaine de pays africains sont sur la bonne trajectoire.
La République démocratique du Congo, avec son plan “DRC Digital Nation”, s’est engagée à reconstruire un état civil fiable et à bâtir une identité numérique nationale, adossée aux technologies de pointe.
L’idée : faire de la donnée citoyenne un levier de modernisation et un symbole de souveraineté retrouvée.
L’Afrique tient dans ses mains un enjeu décisif : rendre chaque citoyen visible, légitime, documenté. L’identité n’est pas qu’un papier, c’est la clé des droits, le moyen d’exister dans l’État, et parfois le premier rempart contre l’exclusion.
En RDC comme ailleurs, la route vers des systèmes d’identification numériques efficaces est semée d’obstacles, mais chaque progrès compte. C’est par ces petits pas (et par la cohérence entre technologies, gouvernance et participation citoyenne) que la souveraineté et la dignité se construisent, document après document.